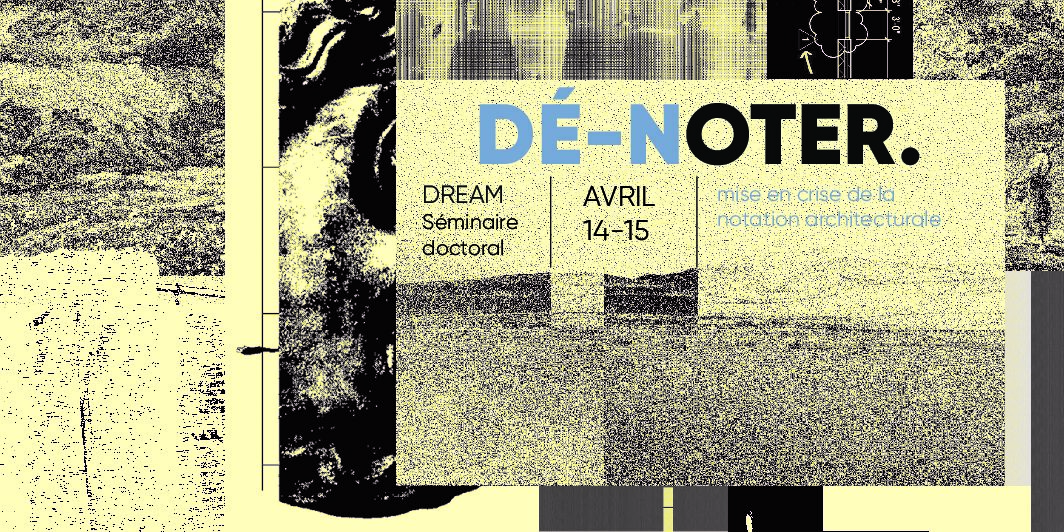Séminaire doctoral de l’ensa•m • DÉ-NOTER • 14 & 15 avril 2023
DÉ-NOTER. Mise en crise de la notation architecturale : Entre dialogue et collisions, que permettent les pratiques représentatives divergentes de l’architecture ?
Séminaire doctoral de l’École nationale supérieure d’architecture de Marseille, organisé en partenariat avec l’Ordre des architectes PACA.
Vendredi 14 et samedi 15 avril 2023, à l’Ordre des Architectes PACA, 12 bd Théodore Thurner, 13006 Marseille
Inscriptions requises : https://framaforms.org/inscription-au-seminaire-doctoral-de-noter-1415-avril-2023-1679413242
Construit de propositions d’architectes, d’artistes, de chercheurs ; convoquant différents champs disciplinaires tout en questionnant la condition de création architecturale, ce séminaire tend à parcourir les récits du faire et se développe au cours de trois axes et thématiques.
Programme
Journée du 14 avril
8h30 Accueil du public et mot d’introduction.
9h Conférence inaugurale de Marc Leschelier, « préarchitecture »
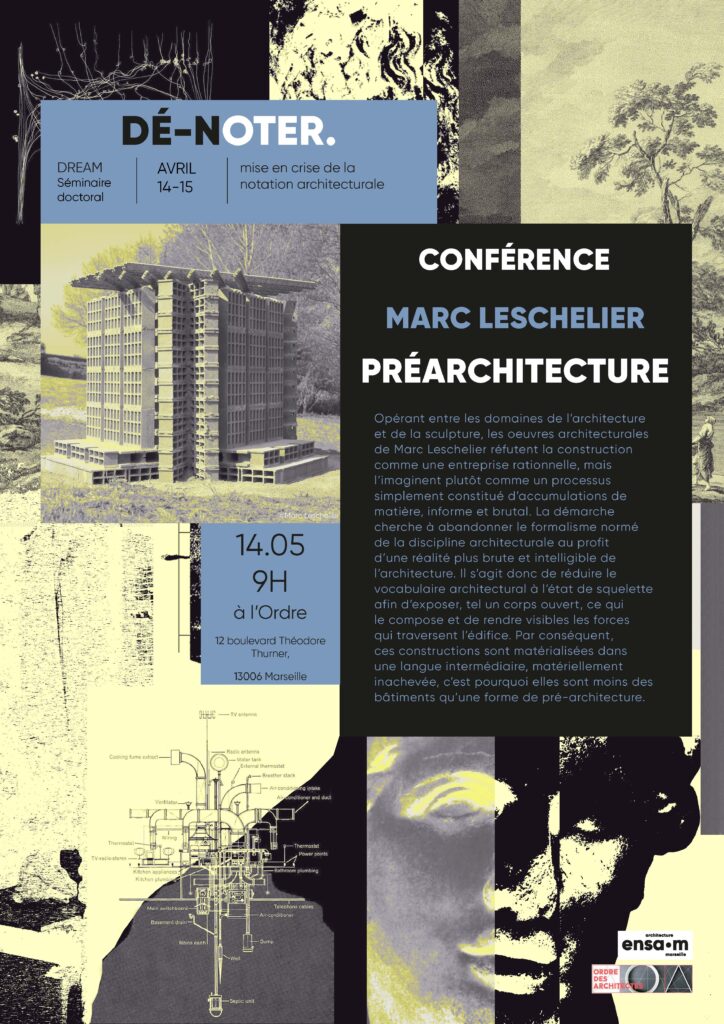
AXE 1 / INVERSER (10h-12h30)
Concevoir dans la dé-notation.
PRÉSENTATION PAR CHIMÈNE DENNEULIN
S’interroger sur les pratiques qui font des disciplines artistiques (poésie, danse, cinéma, peinture, etc.) l’acte fondateur du projet. Comment les pratiques artistiques guident-elles la création architecturale ? Ces pratiques dé-notantes peuvent faire recherche et fabriquer le projet en en redéfinissant les frontières.
Stéphanie Nava
De l’art à l’architecture, histoires dessinées
Cette intervention s’attachera à déplier trois modes de mise en relation de l’art et l’architecture. Il sera question de regarder comment, par la mise en œuvre décalée d’outils de représentation architecturale, notamment coupe et perspective, activer des récits narratifs et conceptuels dans l’œuvre d’art. Puis, l’évocation d’une collaboration avec les architectes Abinal & Ropars sera l’occasion de questionner la traduction d’un dessin architectural en un dessin artistique. Enfin, nous terminerons en observant comment, par une pédagogie expérimentale nourrie des process de l’art, s’initie une pensée par le faire où matière et gestes dessinent la trame sur laquelle élaborer l’architecture.
Sylvain Maestraggi
« Dénoter Athènes », un essai d’archéologie de la nature en milieu urbain
En 2019, je décidais de me lancer dans une exploration d’Athènes à partir du réseau hydrographique de la ville. Au cours du XXe siècle, Athènes a transformé ses rivières en dispositif technique d’évacuation des eaux. La dimension de « vestiges » des derniers lits naturels me conduisit à penser ma démarche comme une « archéologie de la nature ». Pour mener à bien cette archéologie, je me mis à chercher des documents sur l’ancien paysage de la ville, descriptions pour la plupart focalisées sur la topographie des monuments antiques. « Dénoter Athènes », c’était alors, avec le déplacement du regard propre à l’exploration urbaine, relire ces systèmes de notation pour faire apparaître ce qui n’a pas été vu.
Misia Forlen
Des cartes en ligne aux images-réseaux : quelles pratiques pour (se) représenter l’espace habité dans les Zones Économiques Spéciales (France-Pologne) ?
L’espace habité des territoires industriels ne se donne pas à voir directement par la carte. Il s’agit donc de composer les images manquantes de ces zones avec celles et ceux qui l’habitent et en dessinent les contours, intégrant ainsi une dimension créative et interventionniste à la recherche. Ce processus de recherche-création a mené au développement d’un projet documentaire reposant sur le montage de vidéos YouTube réalisées par Becca, Carrie et Joy, trois ouvrières étrangères qui témoignent de leur quotidien en Pologne. Véritable matériau à analyse et à film, ces vidéos permettent d’explorer et de rendre visible les modes d’habiter temporaires qui se déploient aujourd’hui en Europe.
AXE 2 / CONVERSER (14h-17h)
Produire « avec » (con-, cum, avec, commun), dans un double dépassement, entre conversation et conversion.
PRÉSENTATION PAR ANGÉLINE CAPON
Comment subvertir les pratiques de représentations architecturales pour accompagner et favoriser une critique des modes de production et d’aménagement de l’espace ? Appréhender les modes de représentation architecturaux comme autant de dispositifs idéologiques de pouvoir ou de contre-pouvoir.
Marion Howa
Conception ouverte en architecture. Les stratégies documentaires du projet de Beutre
Dans des contextes d’informalités urbaines, les nouvelles pratiques architecturales de conception ouverte avec les communautés habitantes font de l’enquête une stratégie. Elles explorent pragmatiquement des modes de notation où documenter et transformer le réel sont indissociables. En partant des expérimentations documentaires menées dans le projet de Beutre (inventaires, relevés, séries, scripts, cartographies, diagrammes), la contribution veut montrer les agentivités possibles d’une pratique diagrammatique de la notation pour l’architecture : reconnaître les résistances habitantes, prolonger les processus préexistants, favoriser les multiplicités, structurer l’improvisation.
Julie Beauté
La féralité des ruines : Tskaltubo et les dénotations plus qu’humaines de l’architecture
Les ruines des sanatoriums de Tskaltubo, ancienne station de villégiature soviétique en Géorgie, sont façonnées par des agentivités humaines et non-humaines inattendues : elles témoignent d’une fabrique ouverte de l’architecture. Dans ce cadre, la féralité, qui désigne des trajectoires hors de contrôle, du domestique vers le sauvage, souligne les dénotions matérielles non-planifiées, les devenirs incertains des bâtiments, les écarts indéterminés du vivant et de la matière. Contrevenant à une vision soviétique projective, l’écologie férale des ruines met en lumière l’épaisseur temporelle inhérente aux architectures. Elle ouvre ainsi la voie à des récits de matières vives et de métamorphoses.
Camille Valette et Alexis Gallo
Sex, Cruising & Body Building. De la figure du labyrinthe, à son développement rhizomique : imaginaire érotico-politique et perspective révolutionnaire
À travers le développement de cinq érotopies – fictions architecturales, érotiques et queer – de diverses échelles vouées à s’insérer dans les interstices de la ville, le projet tente par la propagation rhizomique, de transformer l’expérience de celle-ci en lui opposant une identité transversale, levier de perturbation manifeste. Ode à l’errance, cette résultante labyrinthique sera ici à considérer telle une figure stimulante, performative et initiatique de la perte, de ses potentialités de résistance et de rupture dans le tissu social existant. Infiltrant ainsi l’ordre établi, la brèche spatiale préfigure une série de perspectives révolutionnaires à échafauder.
Justine Richelle
Notation cartographique – de la posture et du geste ; retour croisé sur deux terrains de recherche, un moment de gare et un atelier d’architecture
À la rencontre d’un mouvement qui façonne, qui agit en nous et nous fait agir, « nous ». L’expérience du flux, du passage piéton, de la gare, révèle et actualise un monde en commun, une manière de faire ensemble, avant toute tentative de « projet » (politique, architecturale, social, …). Ces espaces fugaces, faits de gestes et de postures – composantes mineures de l’urbanité – sont des espaces où s’engage un grand nombre d’individus de manière quotidienne. L’évidence et la banalité de cette nécessité à se mouvoir revêt pourtant un caractère mystérieux car l’expérience manque de récits. Par la « notation cartographique », inspirée par les registres chorégraphiques et anthropologiques proposés par Nicole Harbonnier et Fernand Deligny, l’étude vise à enrichir nos moyens descriptifs face à ces « phénomènes sociaux, anonymes et collectifs, permanents » ainsi nommés par Naoko Abe.
18h Conférence de Charlotte Malterre-Barthes, « Concevoir sans extraire »
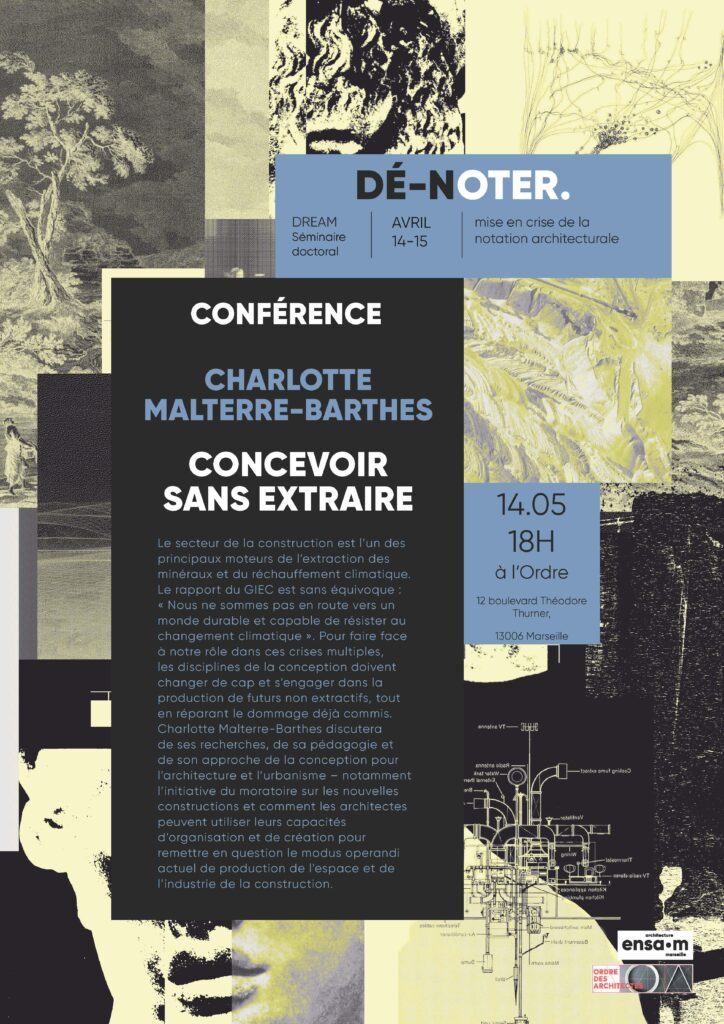
Journée du 15 avril
AXE 3 / TRAVERSER (9h30-12h)
Faire un pas de côté, encore.
PRÉSENTATION PAR PHILIPPINE MONCOMBLE
Témoigner d’opérations architecturales dé-notantes, qui questionnent – ou s’intéressent à celleux qui le font – les formats institutionnels de fabrication de la narration architecturale, voire de l’architecture, voire les limites de notre sujet, … Transversare nous invite à retourner et transformer le sujet même de ce séminaire, jusqu’à une posture iconoclaste ?
Guillaume Aubry
Le nuage de révision. Perturbations atmosphériques du dessin architectural
Parmi l’ensemble des codes graphiques idiomatiques du dessin architectural, certains visent à contextualiser le projet dans sa géographie (indication du Nord, ombres portées…). Le dessin bascule dans un nouveau paradigme atmosphérique : celui d’une représentation graphique du monde vu du ciel qui fait de la personne qui regarde un plan d’architecture un Icare en puissance. Dans ce rapport tout aussi mythique que poétique au plan, je propose de porter une attention particulière à un élément très spécifique apparu en même temps que la CAO dans les années 80 : le nuage de révision, petite perturbation céleste et graphique du dessin qui signale une zone de turbulences du projet…
Eugénie Floret
La perspective de l’évanouissement. Ou comment donner corps au vide, à l’espacement, à l’air, en architecture
Architectes, nous manipulons l’espace, l’air, le contraignons, l’oublions dans une nuée de techniques et de réglementations qui irriguent le bâti. Partant du constat de l’oubli pour engager un souci de l’air, cette contribution envisage l’architecture comme dispositif de mise en mouvement de cette matière spatiale. À travers lignes, points, flèches, tâches, couleurs, voire faisceaux de couleurs, architecture et histoire de l’art s’entremêlent ici pour débusquer l’intangible, troubler l’invisible et ainsi le penser, engager de nouvelles narrations, de nouvelles pensées et pratiques en architecture.
Solène Scherer
Triptyque dénotant : l’Opéra de Vienne, des dialogues d’architectures
Grande scène internationale et attraction touristique de premier plan, l’Opéra de Vienne offre un cas d’étude pertinent pour mettre en lumière les dialogues et confrontations de trois époques et leurs éléments esthétiques et architecturaux. La communication souhaite analyser l’articulation des relations et des évocations entre l’architecture d’origine (années 1860), celle de la reconstruction (années 1950) et les rideaux de scène éphémères qui ponctuent chaque saison et engagent un processus d’effacement par le recouvrement (depuis 1998/1999). Le but est de mettre en lumière les stratégies narratives portées par chacun de ses éléments dans le contexte sociopolitique autrichien.
13h30 Conclusion
14h Mise en discussion des papiers
Présentation des intervenantes et intervenants
Guillaume Aubry est architecte (co-fondateur de l’agence Freaks à Paris), artiste-chercheur (post-diplôme La Seine, Beaux-Arts de Paris) et docteur en art (programme Radian). Il enseigne actuellement à l’École nationale supérieure des arts décoratifs de Paris. Sa thèse porte sur l’expérience esthétique des couchers de soleil. Son dernier livre s’intitule Sunset Cocktails (JBE Books, Paris, 2021).
Julie Beauté est doctorante en philosophie à l’ENS Ulm et ATER à la Faculté de Médecine de la Timone (UMR 7268 ADES, Aix-Marseille Université). Ses recherches mêlent biologie, architecture et philosophie pour proposer un renouvellement du lien entre architecture et écologie. Elle s’intéresse notamment au rôle des trajectoires humaines et autres qu’humaines dans la conception de l’architecture.
Eugénie Floret est architecte, enseignante et doctorante au laboratoire GERPHAU. Ses recherches interrogent l’oubli de l’air pour engager une réflexion sur les potentialités de cette matière spatiale, source de pensées et pratiques en architecture. Elle a récemment publié un article, « L’Oubli de l’air, promenade philosophique en architecture, sur les pas de Luce Irigaray » (Philotope, n°15, 2022.)
Misia Forlen est architecte et doctorante (IDEES Le Havre) dans le cadre du programme RADIAN (Recherches en Art, Design, Innovation, Architecture en Normandie). Son projet « Habiter la zone » associe recherche et créations documentaires pour interroger les enjeux de mobilité liés à l’habitat et au travail dans le secteur de l’industrie, et notamment dans les Zones Économiques Spéciales (ZES).
Marion Howa est docteure en architecture (LRA), architecte praticienne, diplômée en sciences politiques. Ses travaux de recherche-action explorent les pratiques contemporaines de conception ouverte en architecture dans les quartiers populaires. Elle est coauteure de l’ouvrage Les communautés à l’œuvre (dir. C. Hutin, Paris, Carré, 2021).
Alexis Le Gallo est architecte diplômé de l’École nationale supérieure d’architecture de Bretagne et exerce actuellement en Belgique. À l’image du projet Sex, Cruising & Body Building – co-réalisé avec Camille Valette –, il s’intéresse particulièrement à l’architecture comme potentiel outil narratif, spéculatif et critique, desservant un autre aspect plus direct de son approche militante.
Sylvain Maestraggi est artiste. Il s’intéresse aux métamorphoses du paysage, questionnées à partir de la marche, de l’enquête et du relevé photographique. Philosophe de formation, il est l’auteur avec Christine Breton du livre Mais de quoi ont-ils eu si peur ? Walter Benjamin, Ernst Bloch et Siegfried Kracauer à Marseille le 8 septembre 1926 (Marseille, Commune, 2016).
Stéphanie Nava est artiste, maîtresse de conférence en arts et techniques de la représentation – arts plastiques et visuels, à l’École nationale supérieure d’architecture de Toulouse. Le dessin est le médium central par lequel prennent forme ses recherches plastiques qui recouvrent un ensemble de préoccupations relatives à l’espace et à la manière dont celui-ci est organisé, construit et habité.
Solène Scherer est docteure en études germaniques, depuis mars 2023 postdoctorante à l’Université de Lorraine. Elle a soutenu une thèse interrogeant le statut de monument de l’Opéra de Vienne de sa construction à sa reconstruction (1860-1955). Ses thématiques de recherche tournent autour de la notion de monument et des enjeux de conservation-restauration dans l’espace autrichien, sujet de plusieurs articles, dont « Des trésors en danger. Études, reconnaissance et valorisation de l’architecture Nachkriegsmoderne (1945-1973) en Autriche » paru dans le numéro n°47 de la revue InSitu (2022).
Justine Richelle est architecte, doctorante à la chaire « Intelligence Spatiale », LARSH – UPHF à Valenciennes et collaboratrice scientifique au laboratoire SASHA, La Cambre Horta – ULB à Bruxelles. Formée aux arts et à l’analyse du mouvement (OAM – UQAM, Québec), sa recherche démarre par le corps : son mouvement, son langage, les interactions qui le lient à son environnement.
Camille Valette est architecte diplômée de l’ENSA Bretagne et exerce actuellement à Marseille. Elle s’intéresse particulièrement aux thématiques queers et à leurs potentialités en architecture, sujet qu’elle a notamment développé dans son mémoire de fin d’études : « Vers une architecture queerisée, ou comment une approche queer de l’espace peut-elle contribuer à une déconstruction de l’architecture normée et à une création d’espaces autres ? »