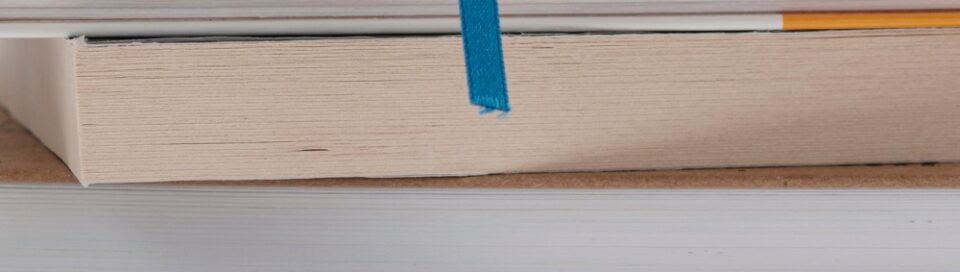Habilitation à Diriger des Recherches • Soutenance • 15 décembre 2023
Muriel Girard, maître de conférences en SHS à l’ensa•m, chercheure au laboratoire INAMA, soutiendra son Habilitation à Diriger des Recherches (HDR) en sociologie, intitulée « Le spleen patrimonial. Acteurs, enjeux et recompositions socio- spatiales dans des villes de la Méditerranée » le vendredi 15 décembre 2023 à l’Université Jean Monnet, de Saint-Etienne ( 13h30 salle K 102, bâtiment K, site Tréfilerie).
La soutenance sera retransmise en direct en salle 309/325
Les personnes intéressées pour suivre la soutenance en direct via zoom doivent demander le lien à Madame Nadine Rolland : ici
Composition du Jury
- Alessia de Biase, professeure en sciences humaines et sociales, ENSA de Paris-La Villette, UMR LAVUE
- Agnès Deboulet, professeure de sociologie, Université Paris 8, UMR LAVUE
- Cyril Isnart, directeur de recherche en anthropologie au CNRS, AMU, UMR IDEMEC (rapporteur)
- Élise Massicard, directrice de recherche en science politique au CNRS, Sciences Po, UMR CERI (rapportrice)
- Sylvie Mazzella, directrice de recherche en sociologie au CNRS, AMU, UMR MESOPOLHIS
- Barbara Morovich, maîtresse de conférences en sciences humaines et sociales, HDR, ENSA de Strasbourg, laboratoire AMUP, IFRA-Nigéria (rapportrice)
- Michel Rautenberg, professeur émérite de sociologie, Université Jean Monnet, UMR Centre Max Weber (garant)
Ce dossier présenté en vue de l’obtention de l’habilitation à diriger des recherches en sociologie est composé de trois volumes :
- un rapport de synthèse retraçant ses activités de recherche et d’enseignement ainsi que son positionnement scientifique (volume 1)
- un inédit de recherche (volume 2)
- un volume regroupant mes publications classées de façon thématique (volume 3).
Résumé de l’inédit de recherche
La recherche inédite discute la pertinence d’une entrée par le patrimoine pour comprendre des dynamiques de transformations sociales et urbaines. En effet, le contexte actuel appelle à repenser les problématiques associées au patrimoine et l’intérêt heuristique de la notion dans la compréhension du monde contemporain. Il questionne le patrimoine urbain dans le capitalisme, face aux enjeux démocratiques et à l’Anthropocène. Ainsi, ce travail interroge les temporalités patrimoniales au regard du temps abîmé qui est le nôtre. Plus spécifiquement, il examine les usages du patrimoine comme ressources au prisme de ce qui est hérité. Les pratiques patrimoniales sont appréhendées en termes de soin et en prenant appui sur les théories du care. L’analyse multi-située montre que le patrimoine peut, selon les situations et les effets produits par la patrimonialisation, être un care ou un « anti-care », notamment quand les effets sociaux de projets de réhabilitation se révèlent excluants.
Ce mémoire fait ainsi dialoguer des terrains menés dans des villes de l’espace méditerranéen relevant de différents contextes : Istanbul et le sud-est turc sur la fabrique du patrimoine (recherches publiées) ; Fès et Tétouan au Maroc sur la circulation des normes, conceptions et modèles de mise en valeur patrimoniale (recherche inédite, non publiée) ; le quartier de La Cabucelle à Marseille sur les enjeux de mémoire et les transformations urbaines (recherche inédite, non publiée). La recherche s’organise en trois parties : 1. Circuler, 2. Atterrir, 3. Rebondir. La première partie, qui rend compte d’investigations menées en Turquie et au Maroc, s’inscrit dans une réflexion sur la globalisation et clôt vingt ans de recherche. Il s’agit d’appréhender, à partir des circulations, les enjeux et les conflits entre acteurs dans la fabrique du patrimoine et les projets de sauvegarde du patrimoine urbain. La deuxième partie, qui prend acte de l’Anthropocène, se situe dans un questionnement sur la façon dont celui-ci oblige à repenser, d’une part, la notion de patrimoine et son apport dans l’étude de la ville et, d’autre part, le travail empirique. Dans cette partie est restituée l’enquête de terrain menée à La Cabucelle à Marseille. Dans ce quartier à la marge des grands projets urbains, le temps est celui de l’incertitude. L’appréhension de ce territoire dévoile des gestes de soin et des traces d’usure ainsi que des pratiques patrimoniales discrètes et ténues. La partie conclusive s’intitule
« Rebondir », dans le double sens de tisser des liens entre des recherches a priori fort éloignées mais aussi d’ouvrir des perspectives futures. En reprenant les thèmes de l’action publique, des traces héritées des périodes impériales, du patrimoine et de l’environnement, elle aborde des encombrants patrimoines. Au-delà, en faisant dialoguer des terrains pris de part et d’autre de la Méditerranée, il s’agit d’amorcer une réflexion sur les apprentissages des « Suds ».